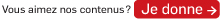Quand un journal va mal, c'est toute la société qui en pâtit... Photo: Spotlight
La presse va mal au Québec. Très mal. Et c'est malheureusement annonciateur de grosses turbulences économiques à l'horizon...
Tout ça a éclaté au grand jour en septembre dernier, lorsque Rogers Communications a annoncé son intention de se retirer complètement du marché francophone des magazines, en mettant en vente L'Actualité, Châtelaine et Loulou. Et ce, «en raison d'une baisse à la fois des revenus publicitaires et du nombre d'abonnés».
C'est un secret de Polichinelle dans le milieu des médias : cela faisait des années que Rogers Communications cherchait un repreneur pour ses publications en français, ne voyant pas d'occasions de synergie entre elles et ses autres activités (radio, télévision, téléphonie, etc.). Des offres lui avaient alors été faites, mais seulement pour certains titres. Rogers les avaient déclinées, refusant de subdiviser la vente : soit quelqu'un reprenait tous les magazines, sans exception aucune, soit la vente n'aurait pas lieu; et la vente n'a jamais eu lieu.
Mon nouveau livre : 11 choses que Mark Zuckerberg fait autrement
À présent, le couperet doit tomber en janvier 2017, si aucun repreneur ne présente d'offre sérieuse d'ici-là. Ce qui, on s'entend, pourrait bel et bien se produire : Rogers aurait alors la belle excuse de dire «Vous voyez, personne n'en a voulu, c'est qu'il n'y avait plus rien à faire avec ces titres-là».
Fort heureusement, nous n'en sommes pas encore là. Plusieurs noms circulent à propos de ceux qui auraient présenté des demandes de consultation des livres comptables des magazines francophones de Rogers, à commencer par celui de l'homme d'affaires Alexandre Taillefer. C'est que celui-ci a récemment mis un pied dans les médias, en reprenant Voir et en ne cachant plus son intérêt pour Le Devoir; il y aurait donc une certaine logique à le voir reprendre L'Actualité, mais quid des magazines féminins?
Qu'est-ce que tout cela met en lumière, au fond? Tout d'abord, le fait que l'avenir à court-terme est carrément incertain pour l'ensemble des journaux au Québec. Ensuite – c'est là un point fondamental –, le fait que l'enjeu dépasse, en vérité, le seul secteur des médias : la santé économique de la province est, à son tour, en jeu. Ni plus ni moins. Explication.
Un véritable bien commun
Pour bien saisir le phénomène qui est en train de se produire sous nos yeux, il faut voir les journaux autrement, c'est-à-dire comme... des exploitants du bien commun qu'est l'information! Dès lors, tout devient clair. Regardons ça ensemble...
Le "prix Nobel" d'économie américain Paul Samuelson a défini en 1954 le bien commun par deux critères nécessaires, lesquels caractérisent parfaitement l'information véhiculée par les journaux :
> Le critère de non exclusion. C'est-à-dire qu'on ne peut exclure personne de son usage. Dans le cas qui nous intéresse, on peut considérer que l'information est libre d'accès : tous les journaux y ont accès, même s'il existe de rares exceptions (ce qu'on appelle les "scoops", qui, soyons honnêtes, ne sont pas si fréquents que ça, et qui, aujourd'hui, sont aussitôt repris par les concurrents...). Et par suite, l'ensemble des consommateurs (ici, les lecteurs) peuvent librement accéder au bien commun qui les intéresse (ici, l'information) : lorsque, moi, je lis un article, ça n'empêche pas qui que ce soit d'autre d'accéder au même article, ça ne prive personne. Bref, quand les Canadiens gagnent un match, tout le monde peut le savoir, sans exception.
> Le critère de non rivalité. C'est-à-dire que l'usage qu'on fait du bien commun n'empêche pas un même usage par autrui. Dans le cas qui nous intéresse, on peut considérer que l'information est inaltérable en dépit de la concurrence : si un journal diffuse une information, ses concurrents peuvent à leur tour diffuser la même information, ou à tout le moins une information d'une qualité comparable à l'originale. Et par suite, chaque lecteur a la possibilité d'accéder à l'information qui l'intéresse dans n'importe quel journal (ou presque, si l'on tient compte des différentes lignes éditoriales des journaux). Bref, quand les Canadiens gagnent un match, tout le monde peut connaître avec précision, entre autres, le score et l'identité des buteurs.
« On le voit bien, l'information est un bien commun. Tout comme, entre autres, l'éclairage public ou la Défense. »
Le hic, c'est qu'une mauvaise exploitation d'un bien commun peut mener à une véritable tragédie, et c'est ce que connaissent aujourd'hui les journaux! De fait, le socio-biologiste américain Garrett Hardin a découvert en 1968 que le libre accès à un bien commun pouvait virer au cauchemar, à l'image de certaines ressources naturelles qui pouvaient, dans certains cas, susciter la prédation et la surexploitation; et par suite, mener les exploitants de ce bien commun-là à adopter des stratégies perdant-perdant.
M. Hardin a donné à l'époque une illustration lumineuse... Imaginons un champ de fourrage commun à un village entier, dans lequel chaque éleveur peut librement faire paître ses vaches laitières. Quel est dès lors l'intérêt purement égoïste de chaque éleveur? D'emmener dans le champ commun autant de vaches que possible, car cela lui permettra de nourrir gratuitement un maximum de bêtes, et donc de s'enrichir à toute vitesse grâce à la quantité accrue de lait produite. Et ce, à plus forte en raison d'un calcul supplémentaire : plus un éleveur emmènera de vaches dans le champ commun, moins les vaches des autres éleveurs auront d'herbe à leur disposition, et donc moins ses concurrents seront en mesure de produire du lait. Or, c'est justement ce calcul-là qui explique pourquoi tout se met à basculer : le champ commun va vite devenir une mare de boue, car plus rien n'y poussera; et tout le monde s'appauvrira brutalement, sans trop comprendre pourquoi.
C'est là ce que M. Hardin a dénommé «la tragédie des biens communs». Et il se trouve que les journaux en pâtissent à leur tour, de nos jours...
Une véritable tragédie
D'après M. Hardin, une tragédie peut se produire lorsque deux conditions sont réunies :
> Un accès totalement libre. Lorsque l'accès au bien commun est totalement libre, et donc lorsqu'aucun titre de propriété ne peut être attribué à quiconque. Or, il est clair que l'information est aujourd'hui la propriété de personne : il suffit de rechercher une nouvelle sur Google pour disposer, d'un clic, d'un nombre considérable de sources journalistiques en traitant.
> Un retour à la rivalité. Lorsque le bien commun redevient un bien propice à la rivalité, et donc lorsque son usage par l'un prive, en tout ou en partie, les autres. Or, il se trouve que nombre de journaux sont aujourd'hui entrés dans la course aux exclusivités, dans l'espoir de se différencier – pour ne pas dire distancer – de leurs concurrents : par exemple, rares sont aujourd'hui les journaux qui n'ont pas installé de «mur payant» (paywall, en anglais) sur leur site Web; d'ailleurs, même le Guardian a annoncé ces derniers jours sont intention d'en bâtir un, «en dépit du fait que cela va a priori à l'encontre de notre philosophie».
Voilà pourquoi nous évoluons à présent en pleine tragédie, à tel point que des publications de renom sont menacées de fermeture.
Toujours selon M. Hardin, il existe trois façons de s'extraire d'une telle tragédie :
1. La nationalisation. L'État devient l'unique propriétaire du bien commun, et exerce dès lors un contrôle total sur l'information, et par suite, sur les journaux. Une telle solution n'est pas envisageable au Québec, car chacun de nous est farouchement attaché à la démocratie : un contrôle total de l'information par l'État ne nous satisferait pas.
2. La supervision. Il s'agit ici de la création par l'État d'un nouveau droit de propriété sous forme de quota d'accès et d'utilisation du bien commun. Autrement dit, l'État superviserait l'existence et la création des journaux, en donnant l'autorisation à chacun d'exploiter le bien commun qu'est l'information «à condition qu'il en reste autant et de même qualité pour les autres», comme l'énonce le principe de légitimité du philosophe britannique John Locke. L'idée serait d'empêcher ainsi toute forme de rivalité, ce qui pourrait se traduire, entre autres, par de larges subventions étatiques généralisées à tous.
3. L'autogestion. Cela revient à adopter le théorème de Coase, qui veut que les exploitants du bien commun se paient les uns les autres de manière à ne pas surexploiter celui-ci. Ce qui pourrait se traduire, par exemple, par la création d'une redevance versée à l'État en échange du droit d'exploiter l'information, une redevance proportionnelle à la puissance de chaque exploitant : on pourrait ainsi imaginer que Google et autres Facebook soient contraints de reverser indirectement de l'argent aux journaux dont ils agrègent les articles sur leurs sites.
Quelle est la meilleure solution pour les journaux québécois? Difficile à dire. Néanmoins, il est clair qu'il est grand temps d'y réfléchir et d'agir!
D'où mon affliction lorsque je vois Mélanie Joly, la ministre du Patrimoine canadien, patiner face aux journalistes montréalais qui lui ont demandé, la semaine dernière, si elle envisageait une aide financière aux médias écrits : «Je sais très bien qu'il y a des bouleversements qui affectent différents médias. J'ai dit à plusieurs reprises : tout est sur la table. Mon équipe et moi, on est prêts à étudier tous les scénarios qui se présentent à nous», a-t-elle dit, sans s'avancer davantage.
D'où mon affliction, encore, lorsque je vois que le prochain congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) ne va pas toujours pas aborder la question de son existence-même, le programme de cette année étant essentiellement axé, comme les années précédentes, sur l'enquête journalistique et le grand reportage, soit la "haute couture" du journalisme («Les limites légales de l'enquête journalistique», «Le journalisme d'enquête selon Isabelle Hachey», «Nourrir le chien de garde», «Mots et maux du terrorisme moderne», «Une idée pour financer le journalisme international», etc.). À aucun moment il n'est prévu d'aborder le sujet – tabou? – de la disparition annoncée du magazine L'Actualité, et encore moins de celle de Châtelaine et de Loulou...
Un véritable péril
L'évidence saute aux yeux : nous souffrons bel et bien de la politique de l'autruche! Et cela risque fort de se retourner contre nous tous...
C'est ce que Luigi Zingales, professeur d'entrepreneuriat et de finance à l'École de commerce Booth de l'Université de Chicago (États-Unis), a explicité il y a de cela quelques mois lors d'une conférence tenue à Londres (Grande-Bretagne). Il s'est alarmé de notre apathie face au dépérissement des médias imprimés occidentaux, une périlleuse apathie car celle-ci, selon lui, laisse «le champ libre au capitalisme sauvage» :
> Vagues de fusions-acquisitions. Dès lors que les médias écrits se mettent à péricliter, on assiste, en général, à une vague de consolidations dans différentes industries. Pourquoi? Parce qu'il y a, selon lui, moins de journalistes susceptibles de se pencher sur les opérations de fusion-acquisition et d'en mesurer les impacts potentiels pour la société; et donc, moins de risques de voir les citoyens s'en plaindre. Et le professeur de Booth de citer en guise d'exemple le fait que c'est un commissaire européen qui s'est indigné, en avril dernier, de «l'abus de position dominante» de Google concernant son système d'exploitation Android, et non pas le moindre média écrit américain : «Combien d'articles négatifs concernant l'emprise abusive d'Android avez-vous lu dans les médias américains?», a-t-il ainsi lancé à l'audience.
> Vagues de fraudes financières. M. Zingales a dévoilé les résultats d'une de ses dernières études à propos des fraudes financières depuis 2007, soit l'année où les médias écrits américains ont dû commencer à se serrer la ceinture. Tenez-vous bien, il a mis au jour le fait qu'aux États-Unis, depuis cette année-là, 1 grande entreprise financière sur 7 avait été mêlée à une fraude financière! Que le montant global des fraudes en question atteignait les 380 milliards de dollars américains. Et que, pour l'instant, aucun haut-dirigeant des ces grandes entreprises financières-là n'avait été mis en prison pour cela.
> Vagues de bulles économiques. Rien que ces dix dernières années, plusieurs bulles économiques sont apparues aux États-Unis : celle du pétrole, celle des prêts automobiles, celle des prêts étudiants, ou encore celle des cartes de crédit. Or, M. Zingales est sur la même longueur d'ondes que l'ouvrage Irrational Exuberance de Robert Shiller, professeur d'économie à Yale (États-Unis), qui veut que la naissance d'une bulle économique coïncide toujours avec la naissance de nouveaux journaux spécialisés dans le même domaine que la bulle. Pourquoi ça? Parce que l'apparition de ces publications traduisent justement l'euphorie qui accompagne l'apparition de la bulle en question. Prenons un exemple... Un beau jour, les gens constatent qu'il n'y a rien de plus facile que d'avoir une nouvelle carte de crédit, et se mettent à consommer plus que jamais. Les journalistes spécialisés en économie sentent vite cette nouvelle tendance, et se mettent à rédiger davantage d'articles sur la finance personnelle; et par suite, des publications entières voient le jour sur ce seul sujet. Or, c'est justement ce à quoi nous avons assisté ces derniers temps, avec l'apparition subite de magazines ultra-spécialisés, dans toutes sortes de domaines. Un signe qui ne trompe pas, à tout le moins pas ceux qui sont avisés, comme MM. Shiller et Zingales; un signe qui montre que l'on va droit à l'épuisement du bien commun.
Voilà. S'il fallait résumer le tout d'un trait, je dirais qu'il n'y a pas d'économie forte sans presse forte! Et que minuit menace de bientôt sonner...
*****
Un rendez-vous hebdomadaire sur Lesaffaires.com, dans lequel Olivier Schmouker éclaire l'actualité économique à la lumière des grands penseurs d'hier et d'aujourd'hui, quitte à renverser quelques idées reçues.
Et mon nouveau livre : 11 choses que Mark Zuckerberg fait autrement